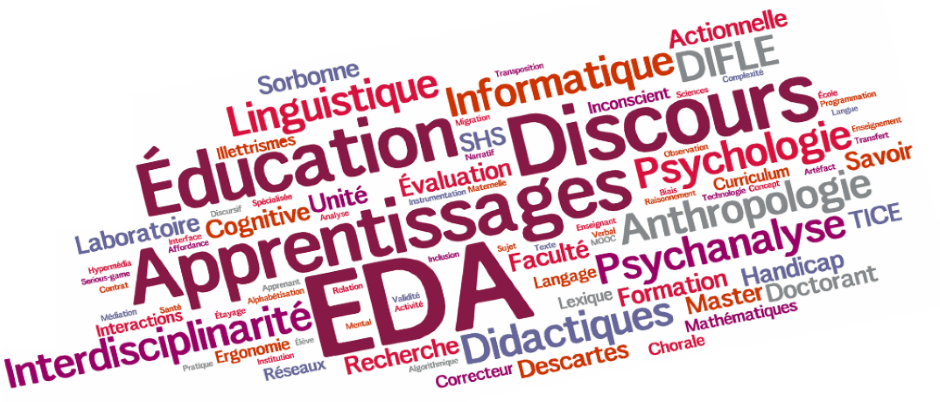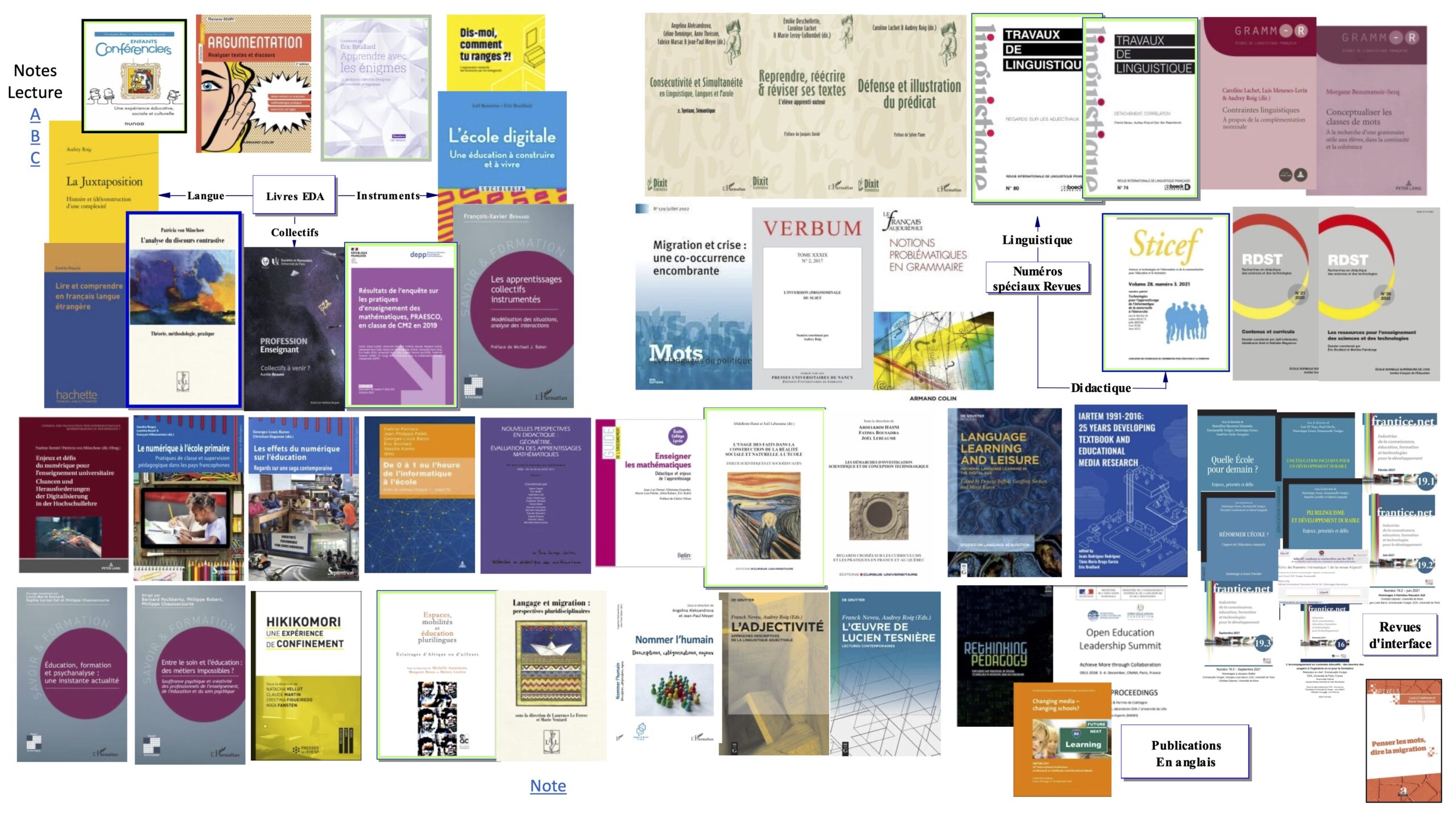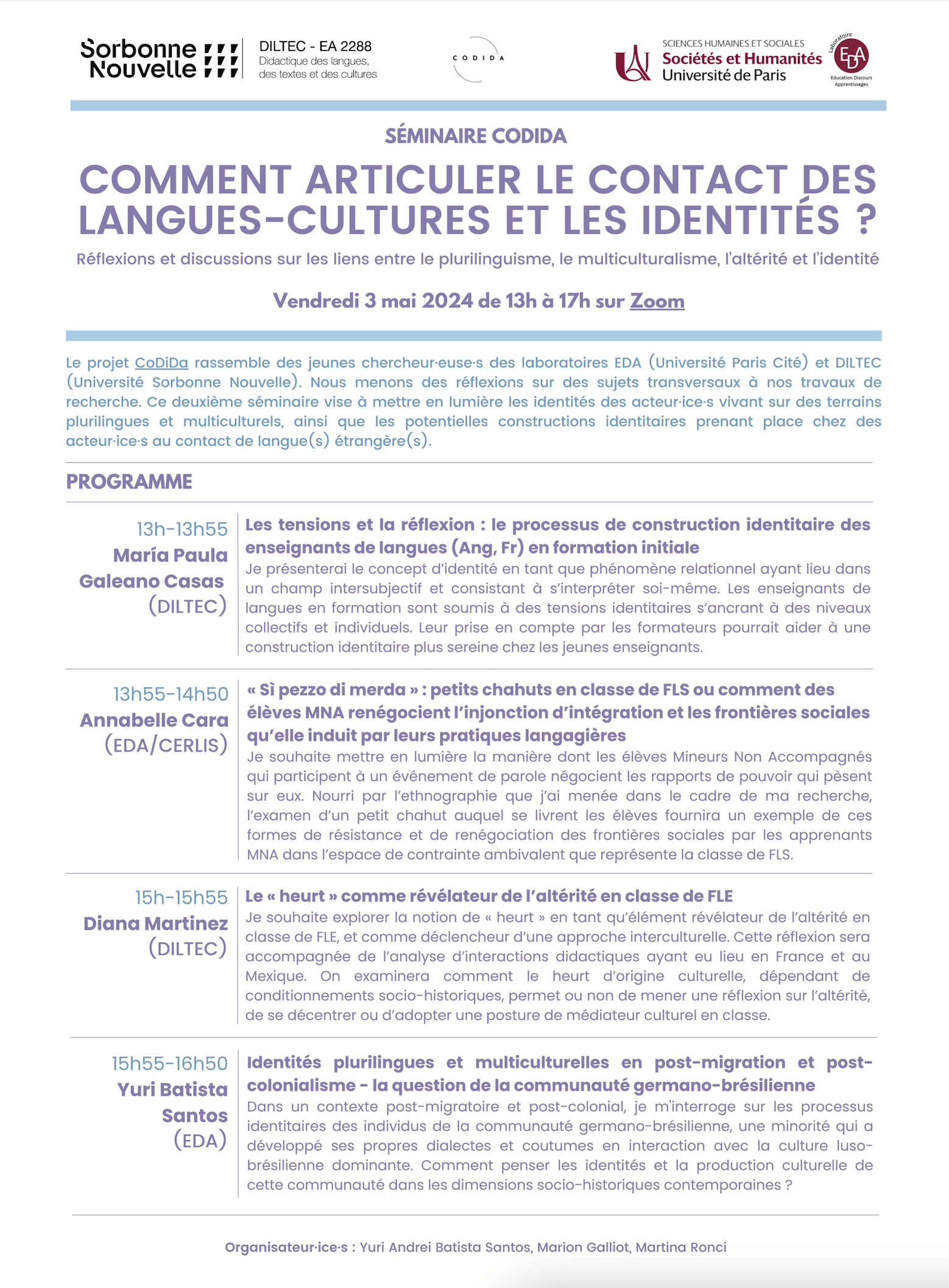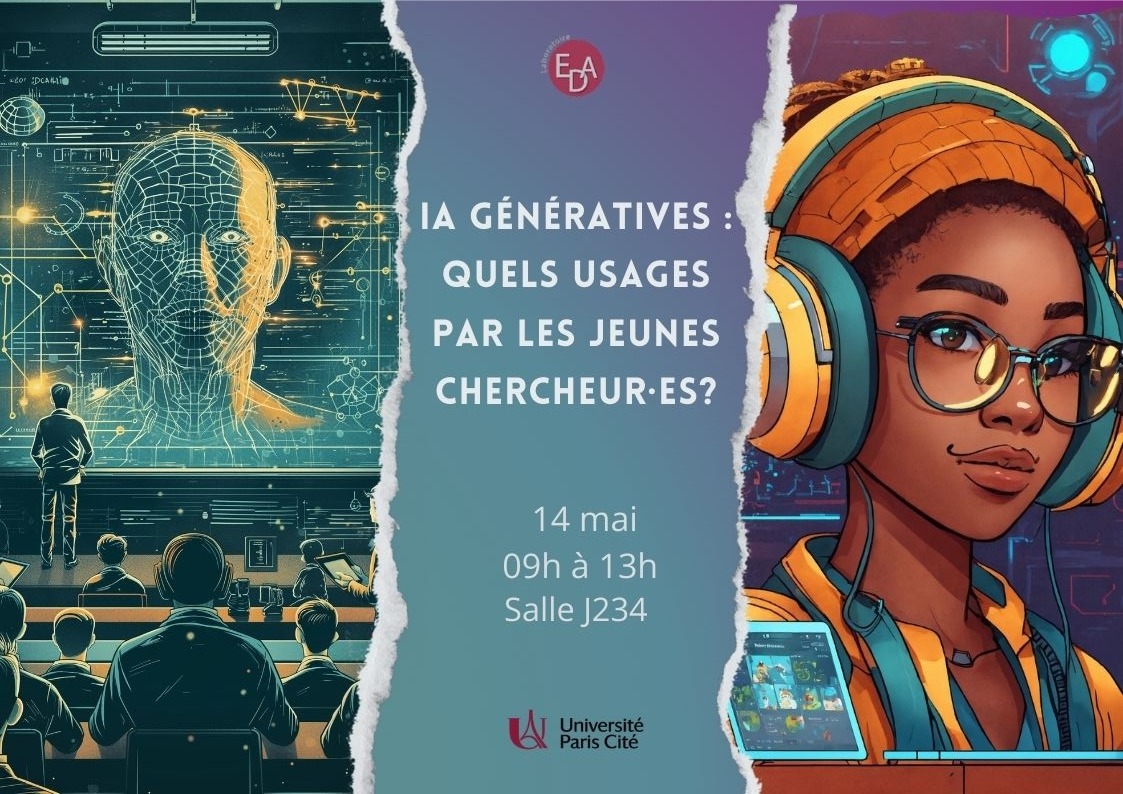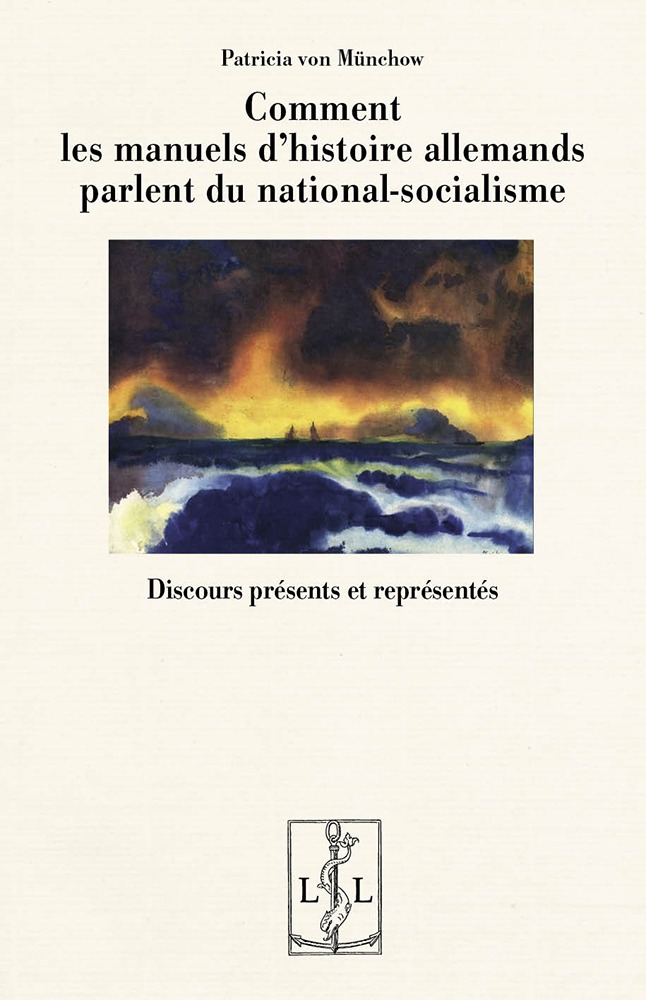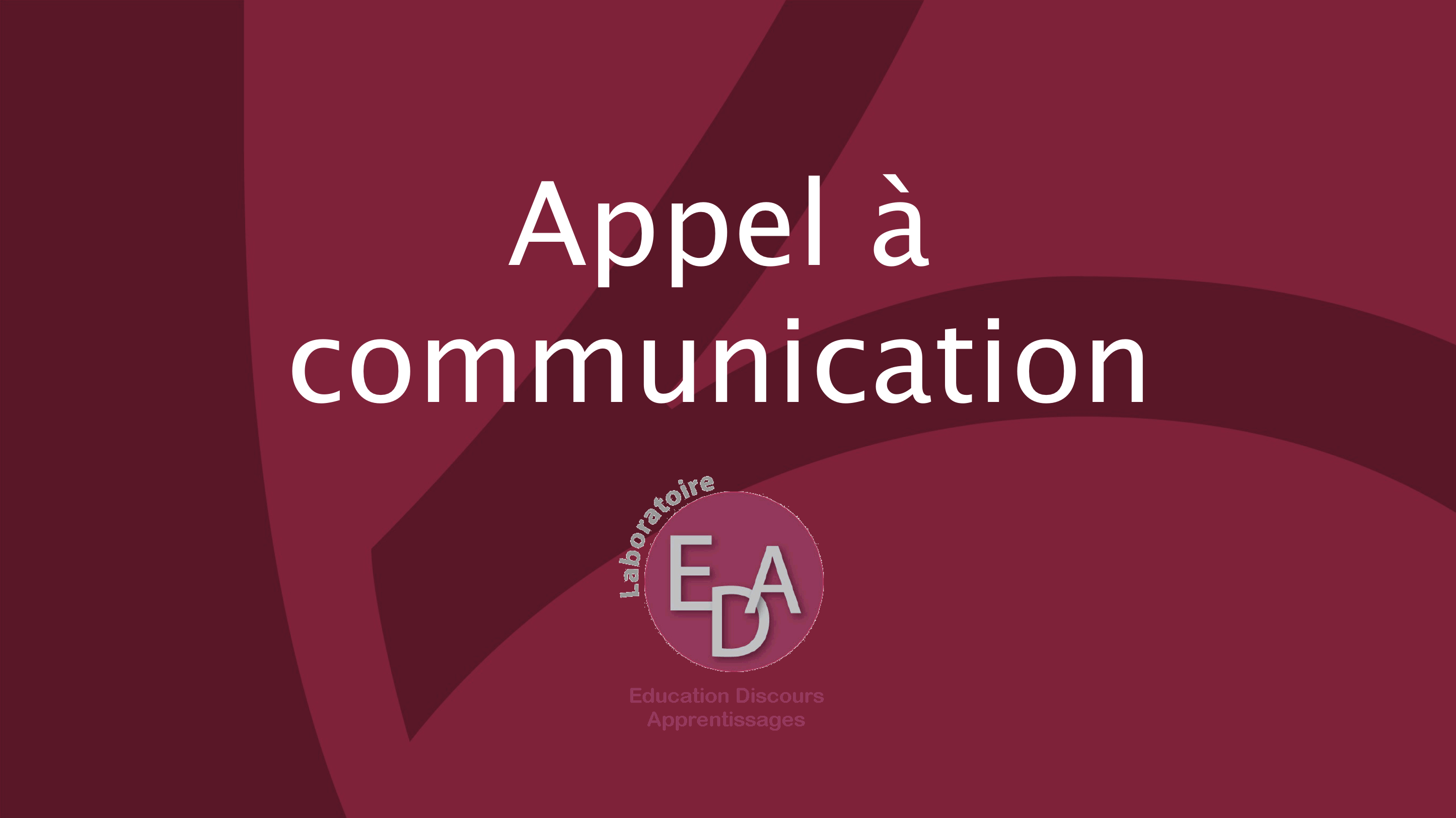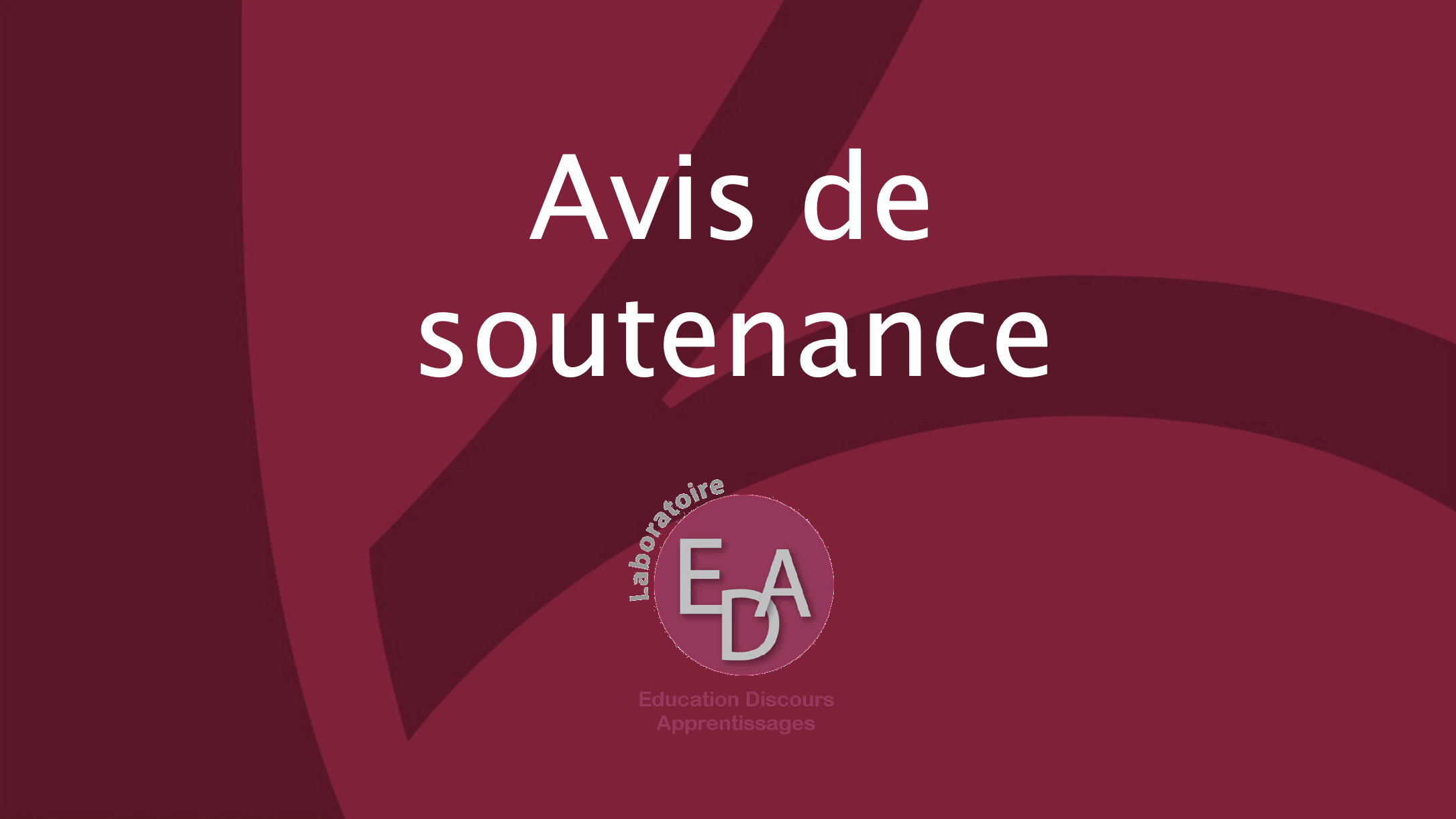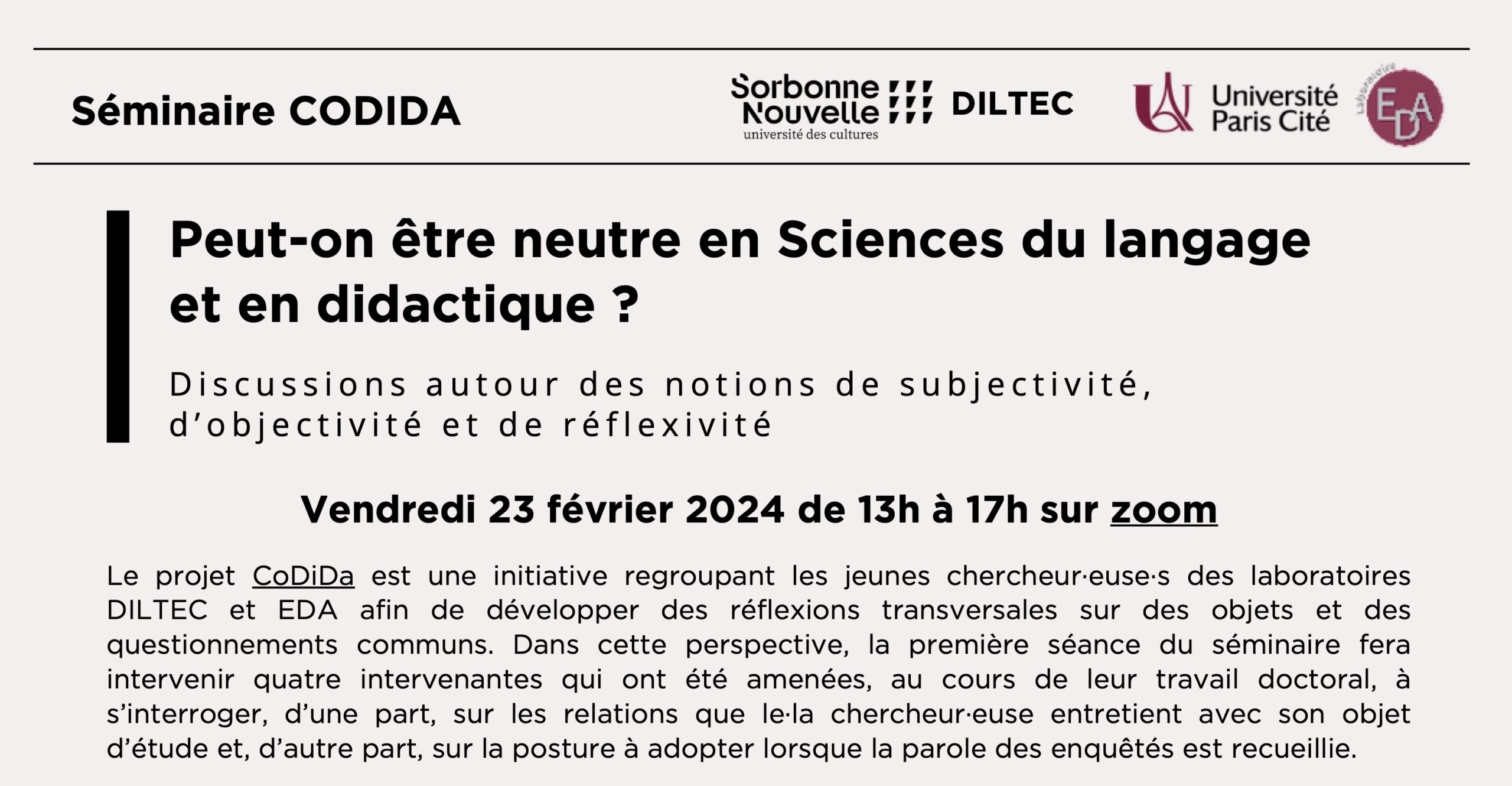Bienvenue sur le site du laboratoire EDA !
Le laboratoire EDA (Éducation, Discours, Apprentissages) est une unité de recherche (URP 4071) qui réunit des chercheurs de différentes disciplines. Leurs travaux participent d’une approche systémique des questions d’éducation et suivent plusieurs trajectoires fortes selon différentes orientations.